L'Invitée des Echos
Manuela-Delia ANGHEL
Représentante nationale de Roumanie au CREFECO
CREFECO : Quelle est la place du français dans l’enseignement en Roumanie ?
 Manuela-Delia ANGHEL : La pratique du français est en Roumanie le fruit d’une longue tradition. Si on l’apprenait autrefois pour avoir accès à la culture française, les objectifs, de nos jours, sont plutôt centrés sur un intérêt professionnel au niveau international et national.
Manuela-Delia ANGHEL : La pratique du français est en Roumanie le fruit d’une longue tradition. Si on l’apprenait autrefois pour avoir accès à la culture française, les objectifs, de nos jours, sont plutôt centrés sur un intérêt professionnel au niveau international et national.
La Roumanie répond aux préconisations de l’Union européenne d’introduire deux langues obligatoires dans le parcours scolaire de tous les élèves: un apprentissage de la première langue dès le CE2 et de la deuxième langue dès la 1ère classe du secondaire inférieur.
La Roumanie est le pays d’Europe qui possède le plus grand nombre d’apprenants de français en tant que langue étrangère avec 1 500 000 élèves environ dans le primaire et le secondaire. Bien qu'enseignée comme langue vivante 1 dans de nombreux établissements, elle a, depuis les années 2000, un statut de langue vivante 2, catégorie dans laquelle elle occupe la première place, loin devant les autres langues de diffusion internationale.
En Roumanie, le français est enseigné à 38% des élèves du primaire et du secondaire comme première langue et à 51% comme deuxième langue. Ces cours sont relayés dans l’enseignement supérieur par 16 départements de français où sont formés professeurs et traducteurs et dans les facultés spécialisées. 40 000 étudiants suivent des formations au français et en français. Par ailleurs, l’enseignement du français (général et spécialisé) est une des activités majeures de l’Institut français de Roumanie, implanté dans 4 villes (Bucarest, Cluj, Iasi et Timisoara), ainsi que des quatre Alliances françaises (Brassov, Constanta, Pitesti, Ploiesti) qui assurent des cours tous publics. Les quatre instituts et les quatre alliances sont aussi centres d’examens pour des tests de niveau et des diplômes reconnus internationalement (TCF, TEF, DELF, DALF). En outre, les quatre instituts interviennent dans la formation continue des professeurs de français et favorisent les séjours d’apprentissage en France.
Il y a 56 sections bilingues pour le français ouvertes dans le secondaire: un maillage qui permet un contact renforcé avec la langue et la civilisation françaises sur tout le territoire.
Le Lycée français Anna de Noailles à Bucarest accueille 850 élèves environ de la maternelle à la terminale. Il est homologué par le Ministère français de l’éducation nationale et est lié par convention à l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) qui lui apporte à ce titre un appui technique et pédagogique.
Le Ministère de l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport et l’Ambassade de France en Roumanie mènent beaucoup d’actions de coopération :
- Le projet bilingue «DE L’ENSEIGNEMENT BILINGUE VERS LES FILIÈRES FRANCOPHONES» - objectifs: rendre plus attractif l’enseignement dans les sections bilingues francophones; renforcer le développement d’une compétence plurilingue; obtenir un statut spécifique pour le cursus bilingue; trouver une meilleure adéquation entre les études secondaires et supérieures; alimenter davantage les filières francophones universitaires. Axes du projet: 29 lycées inclus dans le projet en 2011;
- le baccalauréat mention bilingue francophone;
- le plan conjoint de formation des professeurs de français et de DNL (disciplines non linguistiques)
- le projet «TICE et bilingue» - http://www.vizavi-edu.ro (Bucarest le 17 novembre 2008 - Inauguration du site) – objectifs: promouvoir l'intégration des TICE dans les pratiques pédagogiques; favoriser l'accès aux ressources pédagogiques numériques; former les cadres et les enseignants des lycées bilingues francophones à l'utilisation et l'exploitation pédagogique des TICE; valoriser les CDI comme centres d'accès à l'information; favoriser l'innovation pédagogique et l'interdisciplinarité; dynamiser les filières bilingues francophones en Roumanie et maintenir l'importance de la langue française en Roumanie.
- le site Internet de type «réseau social professionnel» destiné aux 9300 professeurs de français du pays – VizaFLE, inauguré le 21 mars 2011. La création de ce site par l’Ambassade de France en Roumanie, le Ministère roumain de l'Education (MECTS) et l'Association roumaine des professeurs de français (ARPF) a eu pour but l’accompagnement de la réforme de l'enseignement des langues de circulation internationale en Roumanie, qui imposait la mise en place progressive des préconisations du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). C’est un outil qui a permis l’accès à des ressources correspondant aux différents niveaux et compétences du CECRL. Il s’est proposé aussi de créer de fortes synergies pour favoriser les échanges au sein de la communauté des professeurs et de faciliter la communication entre les partenaires locaux, les éditeurs français et les enseignants.
- le projet bilatéral: « PROFIL FLE – Programme franco-roumain de renouvellement de l’enseignement/apprentissage du français dans le système éducatif roumain. » (Bucarest le 20 mars 2012 – lancement officiel) dont les objectifs sont conformément aux directives et orientations données par la Loi de l’Education nationale nr. 1/2011 (LEN): l’adaptation des programmes scolaires au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, aux méthodes d’évaluation des compétences linguistiques et à la formation initiale et continue du personnel enseignant:
- Harmoniser les programmes, les supports et les systèmes d’évaluation de l’enseignement du français;
- Construire une stratégie commune de formation continue des professeurs de français;
- Accompagner la réforme de la formation initiale des professeurs de français;
- Promouvoir l’enseignement du français dans le système éducatif.
CREFECO : Cette année, le CREFECO organise une formation nationale dans chacun des pays membres. La Roumanie a été l’hôte de la première formation de ce type à Iasi. Que pensez-vous de cette nouvelle orientation ?
Manuela-Delia ANGHEL : Cette nouvelle orientation s’est avérée une idée entièrement bénéfique car, par le truchement de l`axe national, elle permet une excellente adéquation aux besoins de formation spécifiques à chaque pays. En même temps, un autre bénéfice est représenté par le nombre considérable de professeurs de français qui peuvent participer aux formations organisées dans chaque pays.
Le stage organisé en Roumanie, à Iasi, du 7 au 11 mai 2012, a eu comme thème « Développer des compétences orales à l'aide de différents supports ». La formation a été animée par M. Pierre-Yves ROUX, Chargé de programmes au Centre international d’études pédagogiques (CIEP) qui est intervenu à de nombreuses reprises sur les problématiques liées à l’oral. Elle s'est déroulée à la Maison du corps enseignant où une trentaine d'enseignants de français roumains étaient réunis.
Les épreuves du baccalauréat pour les langues étrangères, de même que les épreuves des examens DELF / DALF, TEF, TCF accordent une importance toujours accrue à l’oral. Une formation dans ce domaine s’imposait, car on a constaté une certaine « timidité » en ce qui concerne l’utilisation des documents qui développent la compréhension et la production orales. Par conséquent, cette formation a été l’occasion de rappeler la place et les principes propres à l’oral en classe de FLE.
Les démultiplications à travers l’Association Roumaine des Professeurs de français (ARPF), ont été un véritable succès et ont suscité un grand intérêt de la part des professeurs. Des thèmes portant sur le développement des compétences orales, le travail en groupes, mais encore les approches actionnelles ont été à même de fournir aux enseignants des techniques de classe plus appropriées et plus rapides. En outre, les participants ont apprécié les documents mis à leur disposition.
L’initiative des démultiplications ne saurait que renforcer le rôle du français et la formation des enseignants. Il existe un réel besoin de la part des enseignants de se mettre au courant des innovations didactiques. Nous considérons, suite au feed-back reçu de la part des professeurs de français, que les ateliers organisés par le CREFECO contribuent à l’amélioration du travail effectif en classe de FLE. Les thèmes que j’ai choisis, en tant que représentante au niveau national, sont une réponse aux demandes venues de la part des enseignants.
L’ARPF a largement contribué à la promotion des démultiplications CREFECO et a réussi, de la sorte, à élever le niveau de maîtrise des techniques de classe des professeurs membres. Par ailleurs, comme toute association, l’ARPF – par ses nombreuses sections régionales - est en prise directe et permanente avec les enseignants et donc est bien informée quant aux besoins de ceux-ci, un peu partout sur le territoire. La collaboration entre le Ministère de l’Éducation et l’association professionnelle signifie une mise en commun des efforts pour le partage des innovations didactiques dans le domaine du FLE, pour l’augmentation de l’intérêt professionnel et pour l’implication dans l’activité concrète.
CREFECO : Y a-t-il des projets en faveur d’une reconnaissance des formations organisées par le CREFECO au niveau national afin de permettre qu’elles s’intègrent mieux dans le parcours professionnel des enseignants ?
Manuela-Delia ANGHEL : La législation roumaine permet la reconnaissance et l’équivalence de la participation des enseignants aux stages de formation continue en crédits professionnels:
La Loi de l’Education nationale nr. 1/2011 (LEN) – Article 245, (6)
L’Ordre ministériel nr. 5562/2011
La Méthodologie d’accréditation des programmes de formation continue - L’Ordre ministériel nr. 5564/2011 (où s’inscrivent les formations organisées par le CREFECO).
Les enseignants déposent leurs dossiers en vue de leur accréditation au ministère roumain de l’Education, à la Direction Générale des Ressources Humaines et du Réseau Scolaire. Les crédits ainsi obtenus seront pris en compte pour l’accomplissement de la condition juridique qui prévoit que chaque enseignant doit accumuler 90 crédits transférables à des intervalles successifs de cinq ans.
CREFECO : Pouvez-vous nous parler de quelques figures (auteur, personnalité, artiste…) francophones qui ont contribué à la place du français dans l’enseignement en Roumanie ?
Manuela-Delia ANGHEL : Dans la société roumaine du XIXe siècle, le français devient la seconde langue de culture. Le modèle français s’impose, son apogée marquant la seconde moitié de ce siècle. L’influence française se manifeste dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle. Dans ce contexte, un rôle de choix revient à l’enseignement.
Les princes phanariotes, nommés dans les Principautés roumaines ont été éduqués à Constantinople, dans des familles grecques, et ils connaissaient tous le français, l’italien, le grec, le turc. Pour les aider, bien sûr, l’Ambassade de France à Constantinople, leur envoya dès le XVIIIe siècle des secrétaires chargés de la correspondance diplomatique européenne qui, à l’époque, était entièrement rédigée en français. Ces secrétaires donnaient aussi des leçons de français aux enfants des riches boyards. Plus tard, les Français ont ouvert leurs propres écoles pour garçons et filles, en assurant les études secondaires. Tous les représentants de la future élite politique et de l’intellectualité roumaine du XIXe siècle suivirent les cours de ces établissements: Kogalniceanu, Cuza, Alecsandri, Sturdza, Bratianu etc.
Après l’Union des Principautés, le prince Alexandru Ioan Cuza, lui-même francophone et francophile, introduit l’étude obligatoire du français dans l’école secondaire, et à l’Université. Des pensions françaises se multiplient: par exemple, la Congrégation Catholique des sœurs de Notre-Dame de Sion (présente à Galati et à Bucarest).
Les professeurs français faisaient partie du réseau de la Mission Universitaire Française, rattachée à l’Ambassade de France. Au début du XXe siècle et pendant la période de l’entre deux guerres, la bourgeoisie roumaine utilisait le français, lisait la presse et la littérature française.
En 1948, le Ministère roumain de l’enseignement décida de ne plus renouveler le contrat des professeurs français qui travaillaient dans l’enseignement secondaire et universitaire. Les centres d’études françaises, les écoles de sœurs de Notre- Dame de Sion seront fermés. Dans les années 50, le français sera remplacé par le russe.
Parmi les grands professeurs qui ont promu l’étude du français en Roumanie il faut obligatoirement citer le nom de Charles Drouhet (1879-1940). Professeur, critique et historien de la littérature, il est le descendant d’une famille française expatriée qui s’établit en Roumanie.
Disciple de Lanson, mais influencé également par Sainte-Beuve et Taine, Charles Drouhet organise son activité sur deux plans: le plan didactique et le plan de la recherche dans le domaine de la critique et de l’histoire littéraire. On doit mentionner également son orientation vers les études de littérature comparée franco-roumaine.
L’activité de Charles Drouhet a été reconnue et récompensée par la Roumanie et la France: prix Bordin de l’Académie Française, l’Ordre Coroana României, l’Ordre de la Légion d’honneur, etc.
Un autre nom qu’on ne saurait ignorer est celui de Nicolae Serban (1886-1966). Professeur, critique et historien de la littérature, Nicolae Serban fait ses études secondaires aux lycées « Matei Basarab » et « Sfântul Sava » de Bucarest, suivant, après, les cours des Universités de Munich et de Paris.
Il a une contribution fondamentale à la modernisation de l’enseignement du français dans une perspective comparatiste avant la lettre.
Son activité jouit d’une grande reconnaissance nationale et internationale: commandeur de la couronne d’Italie, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Instruction Publique, trois fois chevalier de la Couronne de la Roumanie.
Un foyer de rayonnement du français a été, est et le sera, l’Institut Français de Hautes Etudes, inauguré le 29 mai 1924. Il est né des diligences de l’historien de l’art Henri Focillon, de George Oprescu, du docteur Ion Cantacuzino, de l’historien Nicolae Iorga et d’Emil Racovita, le grand géographe. Ce groupe d’intellectuels trouvera l’appui institutionnel nécessaire dans la personne de Jean Marx, haut fonctionnaire du Quai d’Orsay.
Sous la direction de ses quatre directeurs: l’historien Paul Henry (1925-1932), Alphonse Dupront (1932-1940), Jean Mouton (1940-1946) et Philippe Rebeyrol (1946-1949) l’Institut développe des activités spécifiques: conférences, enseignement du français, choix des boursiers roumains.
Comme réalisations majeures, il faut énumérer l’acquisition en 1936 du nouveau siège de l’Institut, l’actuel immeuble du Boulevard Dacia de Bucarest; et son aménagement, une première semaine du livre français (1-8 décembre 1938), conclusion du premier accord culturel franco-roumain (31 mars 1938), accord qui sera dénoncé unilatéralement par les autorités communistes (novembre 1948), suivi en 1950 par la fermeture effective de la maison.
Aujourd’hui, le français a retrouvé sa place de choix dans la galerie de l’enseignement roumain. Presque tous les élèves de Roumanie étudient le français et ont la possibilité de se familiariser avec les réalités françaises et francophones par l’intermédiaire des instituts et alliances français, par des projets européens. De nombreux jeunes ont obtenu les diplômes de DELF et DALF pendant les dernières années, ce qui atteste l’intérêt toujours croissant pour l’étude du français en Roumanie.



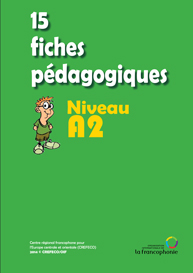
 Formulaire en ligne
Formulaire en ligne Message vert
Message vert Agenda
Agenda