L’Invité des ÉCHOS
Soungalo OUEDRAOGO: Dans son Cadre Stratégique Décennal la Francophonie a inscrit l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche (Mission C), domaines étroitement liés au développement économique, social et culturel, au rang de ses priorités. L’OIF est consciente que la qualité de l’éducation passe impérativement par la qualité de la formation des enseignants, de leurs formateurs et des gestionnaires de l’éducation, et par l’utilisation d’outils d’enseignement modernes et adaptés aux besoins des publics scolaires, notamment ceux liés aux TIC.
L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM), est dédiée au renforcement des compétences et à la professionnalisation des instituteurs. Elle a couvert dans sa phase expérimentale, quatre pays du Sud francophone : le Bénin, le Burundi, Haïti et Madagascar. Cette phase pilote qui a permis la modélisation (y compris le paramétrage des coûts) du dispositif en vue de son appropriation par les pays concernés, a connu une évaluation externe extrêmement positive en 2010 pour le Bénin et le Burundi. Ces deux pays ont amorcé en ce début d’année (2011) la phase d’extension, c’est-à-dire celle du déploiement progressif sur l’ensemble de leur territoire national avec notre accompagnement et la participation d’un partenaire financier de taille, l’Agence française de développement (AFD).
Les centres régionaux francophones (CREF) organisent des activités de formation continue pour les professeurs de français de chaque région concernée (Europe centrale et orientale, Asie du Sud-Est, Océan Indien) et participent à la réflexion sur l’amélioration de l’apprentissage du français et en français dans la région. Ils contribuent aussi à l’élaboration des méthodologies et à la définition des contenus de formation des formateurs, ainsi qu’à l’évaluation des programmes de formation. Ils soutiennent la conception de matériels didactiques pour l’apprentissage du français et pour la formation en présentiel et à distance des enseignants de français.
Pour répondre aux besoins des pays anglophones et lusophones d’Afrique, trois centres de français langue étrangère – situés au Bénin, au Nigéria et au Togo – se sont constitués en réseau - RECFLEA. La DEF appui les actions de ces centres afin de permettre l’émergence d’un pôle régional de compétences et d’expertises. Partant du constat que le français langue étrangère est en pleine expansion en Afrique, il y a urgence à homogénéiser les pratiques pour proposer des programmes communs, innover en matière pédagogique et renforcer la formation des professeurs.
Convaincue que la promotion du français ne peut se faire par opposition aux autres langues, mais bien par une alliance avec elles, au titre du respect de la diversité culturelle et linguistique en général et des langues nationales de ses États et gouvernements, la DEF soutient l’élaboration de politiques linguistiques nationales assurant l’harmonisation et la mise en commun des ressources ainsi que la standardisation des méthodes d’enseignement-apprentissage du français en contexte multilingue. Des outils didactiques convergents (grammaire d’apprentissage, lexiques spécialisés, guides du maître) sont élaborés dans le cadre de plans d’action établis au plan régional.
Un autre aspect que nous avons pris en compte est la formation professionnelle et technique ainsi que l’importance d’adapter les formations au marché de l’emploi. Un de nos programmes est consacré à une meilleure adaptation des politiques de formations professionnelle et technique aux secteurs porteurs pour l’emploi des jeunes et des femmes en particulier. Ce programme contribue au développement et à la diffusion d’outils et de méthodes pour la planification des formations sectorielles et la mise en œuvre d’une approche par compétence dans un ou plusieurs métiers déterminés.
Toutes ces actions démontrent que l’enseignement de la langue française est une des vocations premières de notre Organisation. Notre objectif est de promouvoir et renforcer la visibilité du français et de consolider sa position comme langue de partage, comme outil de communication, de réflexion et de création.
R.Y. : La langue française doit-elle se défendre ?
Soungalo OUEDRAOGO : NON !
On n’a besoin de défendre que ce qui est attaqué. La langue française n’est pas attaquée ; elle est choisie : 220 millions de locuteurs et touche des pays composant plus de 800 millions de personnes. Donc on n’a nullement besoin de la défendre ; il est plutôt question à mon avis de la promouvoir davantage afin que les valeurs qui s’y rattachent soient véhiculées partout où cela sera nécessaire.
Je ne sais pas ce que sous-tend votre question, mais il est possible à mon avis d’associer plusieurs fondements sémantiques au mot défendre : résister à une attaque, venir au secours de ce qui est attaqué, protéger, faire un plaidoyer en faveur de, etc.
Sur le plan strictement linguistique, rien ne prédispose une langue à l’emporter sur une autre et de ce fait, il ne s’agit pas de défendre une langue plus qu’une autre. Si vous utilisez le mot défendre, sans doute est-ce parce que vous faites référence au rapport de force qui s’exprime aujourd’hui en faveur de la langue anglaise vécue comme une menace ? Il est intéressant de noter que de nombreuses langues minoritaires d’Afrique ou d’Asie ne sont absolument pas menacées par l’anglais car leurs locuteurs n’entrent pas dans le cycle économique et de production des pays occidentaux. Aujourd’hui, la domination de l’anglais est d’abord et avant tout l’expression de la suprématie économique et commerciale. Elle n’est donc ni fatale, ni irréversible. Si l’anglais se place en force comme langue de l’économie et de l’emploi, ce n’est pas pour cela qu’elle élimine les autres langues pratiquées au quotidien, dont le français. Prenons l’exemple des pays Scandinaves où l’on enseigne depuis longtemps l’anglais très tôt à l’école par souci de désenclavement. A ma connaissance, cette pratique n’a eu aucune répercussion sur les langues nationales connues d’eux seuls. Pour qu’une langue soit gravement menacée, il faut qu’elle disparaisse des foyers.
Le français est encore très parlé à la surface du globe. De nombreux groupes de populations l’utilisent encore pour des raisons historiques ou culturelles. Si l’on se réfère au baromètre Calvet des langues du monde qui permet d’évaluer le poids des langues en se basant sur des critères tels que l’indice de développement humain, langue officielle, traduction langue source, traduction langue cible, taux de pénétration d’Internet, nombre d’articles dans Wikipédia, etc. le français se porte très bien. Il ne s’agit pas de le défendre « en particulier » pour ce qu’il représente ou a pu représenter, mais plutôt d’éviter son exclusion linguistique au même titre que d’autres langues, face à l’anglais aujourd’hui, face au chinois peut–être demain. C’est pour cela que l’OIF favorise, dans tous ses programmes, la diversité linguistique et culturelle, et défend, en particulier dans le domaine de l’enseignement des langues, le multilinguisme. Nous œuvrons pour l’équité des langues, quelles qu’elles soient. Nous sommes contre le monolinguisme, et à ce titre, nous défendons le droit à toutes les langues.
R.Y. Quel est le professeur de français qui a laissé une trace durable dans votre formation ?
Soungalo OUEDRAOGO : Le frère André FRAYSSE au lycée moderne Saint-Viateur de Bouaké en République de Côte-d’Ivoire dans les années 1970 lorsque j’étais en classe de première. Il s’agissait d’un établissement privé catholique où la majorité des professeurs étaient des frères religieux ou des prêtres.
Le mérite du frère FRAYSSE a été de transformer le ‘’scientifique’’ que j’étais ou prétendais être en amoureux de la langue et de la littérature françaises. Il n’était pas seulement un professeur de français ; il portait en lui l’amour et la valeur intrinsèque de cette belle langue et a réussi à me ‘’contaminer’’. De par son action positivement persuasive, j’ai pu compter parmi les meilleurs élèves de français, je dirais même le meilleur à un moment de ma vie scolaire au lycée au point d’être le rédacteur-en-chef et le directeur du journal du lycée ‘’La Voix de Saint-Viateur’’.
Le frère FRAYSSE s’était également distingué par ses méthodes pédagogiques et sa didactique du français propre à lui : au lieu de nous enseigner le français de façon magistrale à travers la littérature par la méthode traditionnelle chapitre après chapitre et auteur après auteur, il avait plutôt découpé le programme annuel en autant de morceaux que de groupes d’élèves constitués par lui-même. Ce qui fait que chaque groupe s’était vu attribuer plusieurs auteurs et œuvres littéraires qu’il devait étudier à fond dans un laps de temps défini puis en faisait un exposé interactif au reste de la classe dans une ambiance culturelle et festive (exposés et questions entrecoupés de pauses musicales).
Pour l’adolescent que j’étais c’était fantastique. En six mois nous avons bouclé le programme de l’année et nous connaissions presque par cœur les grands classiques de la littérature française. Pour les trois autres mois restants de l’année scolaire, nous donnions libre cours à notre imagination ainsi rendue fertile pour nous essayer à la poésie, au roman, à la stylistique, etc.
Un autre atout de cet inoubliable enseignant émérite résidait dans le fait que les sujets de dissertation française qu’il nous soumettait avaient entière prise sur nos réalités locales et les préoccupations bien ciblées des adolescents que nous étions.
Sacré Frère FRAYSSE !



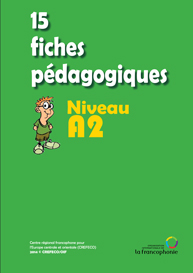
 Formulaire en ligne
Formulaire en ligne Message vert
Message vert Agenda
Agenda